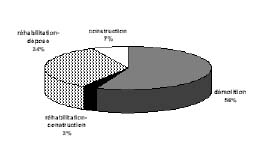
|
Recommandation n° T2-2000 aux maîtres d'ouvrage publics relative à la gestion des déchets de chantiers du bâtiment (GPEM/TMP) |
Préparée par le GPEM "Travaux et maîtrise d'œuvre" et adoptée le 22 juin 2000 par la section technique de la Commission centrale des marchés
La présente recommandation a pour objet de fournir aux maîtres d'ouvrage les moyens susceptibles de favoriser l'adaptation des pratiques du bâtiment à la réglementation sur les déchets, et notamment à l'accent mis sur la nécessité de leur valorisation.
Les travaux de bâtiment sont à l'origine d'une production annuelle d'environ 30 millions de tonnes de déchets de chantier de nature très diversifiée. On y retrouve en effet :
Ces déchets proviennent soit des chutes ou des reprises de mise en œuvre (construction neuve), soit de la dépose des produits et matériaux (démolitions totales ou partielles). La répartition entre les différents types de chantier s'établit de la façon suivante :
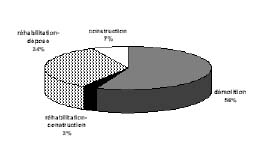
La gestion de ces déchets est devenue plus onéreuse et plus complexe, compte tenu de l'évolution de la réglementation relative à l'élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l'environnement.
En effet la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement qui a modifié la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 définit les nouveaux principes de la politique nationale de gestion des déchets (comme la réduction de la production et de la nocivité des déchets) ainsi que ses modalités d'application.
Il s'agit notamment de :
Il n'est en conséquence plus possible d'avoir, pour l'ensemble des déchets du bâtiment, un exutoire unique et gratuit compatible avec la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement(1). L'annexe n° 1 rappelle les filières accessibles à chaque catégorie de déchets.
L'addition de ces dispositions aux nouvelles exigences en matière de transports et de valorisation des emballages a conduit à un bouleversement de la situation pour le secteur du Bâtiment qui voit les coûts d'élimination de ses déchets augmenter très sensiblement.
Or la première loi relative à l'élimination des déchets de 1975 prévoit que la responsabilité en matière d'élimination des déchets repose sur le détenteur ou le producteur des déchets.
La rédaction de l'article 1er de cette loi "Toute personne qui produit ou détient des déchets" est suffisamment large pour que chacun des intervenants soit concerné par le non-respect des dispositions légales. Il ressort de la jurisprudence française et européenne que le maître d'ouvrage peut être tenu pour responsable (cas de la démolition d'un silo à grains - Cour de Cassation, 9 juin 1993).
La présente recommandation traite successivement :
La nouvelle réglementation sur les déchets doit conduire à un changement profond des pratiques des entreprises. Des déchets mélangés impliquant une élimination dans les installations les plus contraignantes et donc les plus coûteuses, un tri sélectif des déchets devra être envisagé soit sur le chantier chaque fois que cela est possible(2) (c'est-à-dire notamment dès lors que les contraintes en terme d'espace ou de nature des déchets le permettent) soit via une plate-forme de tri hors chantier. De toutes façons l'élimination des déchets de chantier devra être assurée prioritairement vers des filières de valorisation.
La prise en compte de cette démarche et son impact sur l'organisation du chantier auront une incidence financière d'autant plus importante que la problématique des déchets n'aura pas été abordée dès l'élaboration de la proposition. Malgré l'effort de sensibilisation et d'information engagé, notamment au niveau des organisations professionnelles, il est à craindre que la prise en compte des nouvelles contraintes par les entreprises ne s'opère que trop lentement.
Il y a, dans ce cas, risque que la réglementation ne soit pas respectée par les entreprises qui ne l'auront pas intégrée dans les conditions de réalisation des travaux.
Pour réduire ce risque, il appartient aux maîtres d'ouvrage d'inciter les entreprises à prendre en compte les nouvelles conditions de gestion et d'élimination des déchets(3), et à rechercher dès le départ, les solutions respectueuses de la réglementation les plus économiques, en exigeant que la proposition de l'entreprise fasse apparaître de manière bien individualisée le mode opératoire envisagé pour la gestion et l'élimination des déchets de chantier, ainsi que le coût correspondant.
Par ailleurs, dans un souci évident d'économie d'échelle, il convient, lorsque plusieurs corps d'état interviennent pour un même chantier, d'encourager la mise en place d'une organisation commune pour la gestion et l'élimination des déchets. Dans ce cas, le coût de cette organisation ne doit pas être intégré dans le compte prorata, dont le mode de répartition, fonction du montant des marchés, ne reflète pas la part de chaque entreprise dans la production des déchets. Cette répartition devra donc être négociée entre les différentes entreprises concernées, sans intervention de la maîtrise d'ouvrage.
Enfin, le souci d'identification en matière de déchets, ainsi
que celui d'aboutir à une organisation de chantier unique, pourrait conduire à
envisager un lot spécifique pour la gestion et l'élimination des déchets. Cette
pratique est à déconseiller, en l'état actuel, car, d'une part, elle n'incite
pas chacune des entreprises à rechercher les solutions les plus adaptées, et,
d'autre part, elle risque d'entraîner une duplication des coûts.
Le cas de la démolition
S'il incombe à l'entreprise de définir les modes opératoires et la méthodologie de démolition, ainsi que les filières locales d'élimination et de valorisation, il appartient au maître d'ouvrage de faire définir la nature et la quantité des composants de l'ouvrage à démolir aussi précisément que possible.
À cet effet, il est recommandé au maître d'ouvrage, lors de la programmation de l'opération, de réaliser ou faire réaliser un "diagnostic déchets" de l'ouvrage à démolir.
Ce diagnostic, qui ne préjuge en rien de la réalisation d'autres diagnostics prévus par la réglementation (concernant l'amiante par exemple), est destiné à fournir au maître d'ouvrage les quantités présentes de déchets par catégorie ou nature. Cette étude, qualitative et quantitative, fera partie intégrante du programme de l'opération arrêté par le maître de l'ouvrage.
En outre, chaque fois que c'est possible, il y a lieu de réunir, à titre d'information, des indications sur :
Lors de la préparation des Dossiers de Consultation des Entreprises, il est recommandé :
Il est rappelé que des propositions de rédactions des clauses à intégrer dans le CCAP et le CCTP de l'opération sont disponibles dans le document diffusé par la Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction (DGUHC) "Méthodologie de prescription et de choix des offres sur la démolition - 1997".
Le règlement particulier de la consultation devra préciser, en tout état de cause, dans quelles conditions seront présentées les offres des entreprises. Deux solutions peuvent être envisagées :
Première solution
Le maître de l'ouvrage joint au dossier de consultation le diagnostic préalable qu'il a fait établir, ainsi qu'un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, élaboré sur la base des quantités du diagnostic.
L'entrepreneur établit sous sa responsabilité son prix global et forfaitaire, sur la base de quantités qu'il aura lui même estimées au cours d'une visite du chantier. Le maître de l'ouvrage prévoit à cette fin pour chaque candidat une visite séparée des immeubles à démolir. Il prend en compte dans les délais accordés aux entreprises le temps nécessaire à l'élaboration d'une offre avec gestion spécifique des déchets.
Le prix global et forfaitaire remis par l'entreprise ne pourra plus être modifié. Cependant, l'entreprise retenue à l'issue de la consultation disposera d'un délai, à préciser dans le règlement de consultation, de 8 jours au minimum pour procéder à une vérification des données qualitatives et quantitatives de la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.), lesquelles serviront à la gestion et au contrôle.
La D.P.G.F., éventuellement complétée en cas d'erreur, est à annexer au marché en précisant qu'elle n'est destinée qu'à permettre le contrôle de l'exécution conforme de l'élimination de l'ensemble des déchets : en raison de la définition d'un marché forfaitaire, aucun recours ayant trait à l'incidence financière des quantités n'est admissible de la part des entreprises.
Deuxième solution : un dispositif décrit par la circulaire du 9 mars 1982
Pour la détermination du forfait, l'annexe à la circulaire du 9 mars 1982 du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'urbanisme et du logement décrit une solution qui peut être adaptée, lorsque le dossier de consultation contient le descriptif précis et complet de l'ouvrage à démolir ainsi que tous les plans d'exécution ou, tout au moins, la totalité de ceux qui peuvent être utilement arrêtés avant que soient connus les moyens et les techniques de l'entreprise retenue.
Le maître de l'ouvrage demande aux entrepreneurs d'établir leurs prix sur la base des quantités figurant sur le cadre de la D.P.G.F., et correspondant à celles du diagnostic joint au dossier de consultation. Toutes les offres peuvent ainsi être jugées sur les mêmes bases.
Seule l'entreprise à retenir sous réserve de vérification des quantités est ensuite invitée à vérifier les quantités, pendant la période de mise au point du marché. Si cette vérification ne conduit pas à un écart de prix supérieur à 3 %, l'entreprise est retenue et le forfait définitif est fixé à ce moment. Au delà de cette valeur, le maître de l'ouvrage devra procéder à une nouvelle consultation sur de nouvelles bases.
La D.P.G.F., éventuellement rectifiée, est à annexer au marché en précisant qu'elle est destinée à permettre le contrôle de l'élimination des déchets : par la suite, en raison de la définition d'un marché forfaitaire, aucun recours ayant trait à l'incidence financière de ces quantités ne sera admissible de la part des entreprises.
Quelle que soit la solution retenue pour la présentation des offres des entreprises, les quantités et les modes d'élimination retenus dans le marché à la suite de la vérification de l'entreprise serviront de référence au contrôle du respect de l'élimination des déchets du chantier. Celui-ci sera assuré au moyen des bordereaux de suivi cités ci-dessus, à remplir par les différents acteurs successivement concernés et à retourner au maître d'ouvrage.
À la vérification de ces bordereaux, si les quantités réellement éliminées dans chaque filière sont inférieures de plus de 5 % en poids aux quantités retenues dans le marché, l'entreprise titulaire du marché de démolition est invitée à justifier par écrit cet écart. L'irrecevabilité desdites justifications ne pourra être invoquée que si elle est fondée.
Le maître d'ouvrage précise dans le C.C.A.P. les pénalités
applicables en cas d'écart non justifié ou non accepté par lui, indépendamment
de la saisine du service local chargé de l'Inspection des Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement pour suspicion de dépôt illégal de
déchets.
Le cas de la construction neuve
Le cas de la construction neuve se différencie de celui de la démolition par plusieurs éléments :
On peut réduire à la source la quantité et la nocivité des déchets produits lors des phases de mise en œuvre par le choix des techniques constructives retenues et par le soin apporté au stockage et à la manipulation des matériaux entrants (limitation de la casse) et à leur mise en œuvre (limitation des chutes) ;
Par nature, la décomposition en phases des différentes tâches et de l'intervention des différents corps d'état fait que les déchets produits n'ont pas la vocation irrémédiable d'être mélangés. Ce "non-mélange" doit être encouragé, d'une part pour faciliter l'élimination des déchets dans les centres de stockage prévus par la réglementation, d'autre part pour ne pas amoindrir la qualité de ces déchets à la sortie du chantier qui détermine leur faculté à être recyclés.
L'application et la mise en œuvre de ces principes devront être encouragées dès lors que les conditions le permettent.
Cependant dans tous les cas il est recommandé aux maîtres d'ouvrage de s'appliquer au moins à faire préciser par les entreprises, le plus clairement possible, le coût de l'élimination des déchets produits par leur chantier et les filières d'élimination retenues, en privilégiant celles qui permettent de limiter la mise en centres de stockage et de favoriser la valorisation.
Pour ce faire, il est proposé la méthodologie qui suit :
Lors de la préparation des Dossiers de Consultation des Entreprises, il est recommandé :
1. De demander systématiquement aux entreprises de fournir lot par lot les estimatifs de leurs déchets, leur mode d'élimination (filières, éventuellement logistique associée...) et le coût correspondant à faire apparaître comme une ligne supplémentaire de la formation de l'offre dans la décomposition du prix global et forfaitaire.
En application de l'article 81 du Code des Marchés Publics, cette ligne dans la DPGF peut faire l'objet d'une demande de devis détaillé qu'il est recommandé au maître d'ouvrage de solliciter pour lui permettre une estimation de l'offre. Ceci ne représente pas un engagement contractuel.
La difficulté d'une telle démarche réside dans la quantification a priori des déchets produits par un chantier de construction neuve et, en conséquence, dans la validité des chiffres avancés par les entreprises(4).
2. Hors le cas des marchés passés en corps d'état séparés, de prévoir dans le CCTP un article relatif à la gestion globale des déchets produits sur le chantier intégrant les éléments ci-dessus et allant dans le sens soit d'un tri et stockage sélectif sur le chantier soit de choix d'exutoires permettant un tri ultérieur et limitant au final la mise en décharge. Le délai de soumission des entreprises devra être compatible avec la prise en compte de cette exigence notamment dans le cas des marchés en groupement d'entreprises. Dans le cas de marché unique dit "en entreprise générale", il incombe à celle-ci de définir les règles communes à appliquer par ses sous-traitants.
3.Dans le cas de marchés séparés par corps d'état, de prévoir un ensemble cohérent d'articles aux CCTP et CCAP afin que, dans chaque cahier des charges, des stipulations précisent les obligations contractuelles et, le cas échéant, les prestations (par exemple le tri sur chantier, ou le stockage sélectif,...), de chaque corps d'état, les sujétions et modalités d'exécution, de coordination et de gestion technique (exutoires permettant un tri ultérieur...). Les éléments méthodologiques cités plus haut y seront intégrés et la compatibilité avec le plan général de coordination devra être vérifiée.
4.De prévoir le suivi, par le maître d'œuvre, de
l'élimination des déchets produits par le chantier : suivi des prescriptions
générales sur le tri - si celui-ci est possible -, des dispositions prévues pour
l'organisation du chantier et des bordereaux d'élimination des déchets comme
pour la démolition. Ce suivi devra être intégré dans un chapitre particulier du
récapitulatif demandé par le maître d'ouvrage au titre du 6° de l'annexe I de
l'arrêté du 21 décembre 1993. Compte tenu de la difficulté actuelle d'estimation
des quantités de déchets produits dans les chantiers de construction neuve, il
n'est pas recommandé, contrairement au cas de la démolition, de prévoir des
pénalités, le suivi ayant notamment pour objet d'améliorer la connaissance dans
ce domaine, par capitalisation des informations recueillies dans le cadre de la
procédure préconisée.
Le cas de la réhabilitation
Les travaux de réhabilitation comprennent généralement une phase de dépose et / ou de démolition, plus ou moins importante, suivie d'une phase de mise en œuvre de matériaux neufs.
Pour cette dernière, il conviendra d'appliquer les recommandations ci-dessus concernant la construction neuve.
La conduite à tenir pour les travaux de dépose et de démolition dépendra de leur volume.
Si celui-ci est important, il sera souhaitable que le maître d'ouvrage réalise ou fasse réaliser un "diagnostic déchets" préalable, comme dans le cas de la démolition. Toutefois, en matière de réhabilitation, la création d'un lot spécifique "démolition" ne se justifiera pas toujours. Il conviendra alors que le diagnostic soit décomposé en corps d'état, et que chaque corps d'état concerné par une dépose fournisse les documents définis en annexes n° 2 et 3.
Si le volume de dépose et de démolition n'est pas important, l'audit ne s'avérera pas nécessaire et chaque corps d'état devra fournir les informations décrites dans le chapitre "construction neuve", en prenant en compte, non seulement les déchets provenant de la mise en œuvre des matériaux neufs, mais également de ceux provenant de la dépose.
Dans tous les cas, il importe que les documents graphiques et
écrits fournis aux entreprises décrivent de la manière la plus précise les
parties d'ouvrage à déposer et à réhabiliter.
Déconcentration du conseil aux
acheteurs publics Un premier site a été installé par la direction générale de la
comptabilité publique à Lyon. Il a vocation, en liaison avec la direction des
affaires juridiques, à renseigner les acheteurs ayant leur siège dans les
régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les organismes publics concernés sont donc invités désormais à
présenter exclusivement leurs demandes de renseignements concernant les marchés
publics, par téléphone, au numéro suivant : 04 72 56 10 10, et ce du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.
(1) Pour les centres de stockage de
déchets inertes dits de "classe III", une nouvelle réglementation est
susceptibles d'intervenir en application de directives européennes.
(2) La Commission Européenne a
entrepris des travaux sur ce sujet.
(3)Pour une opération comprenant des
terrassements, il conviendra de prendre en compte la pollution éventuelle des
sols et le traitement de ceux-ci.
(4) On peut espérer que de nouveaux
outils viendront permettre leur validation. En attendant, il conviendra par
exemple :
Il est pour l'instant difficile d'aller plus loin en terme
d'outils (si ce n'est obtenir des statistiques fiables par corps d'état ou par
tâche).
Directeur de la publication : Alain TESSIER
Commission
paritaire des publications et agences de presse n° 1411 AD-ISSN
0153-5242© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - 18
avril 2001